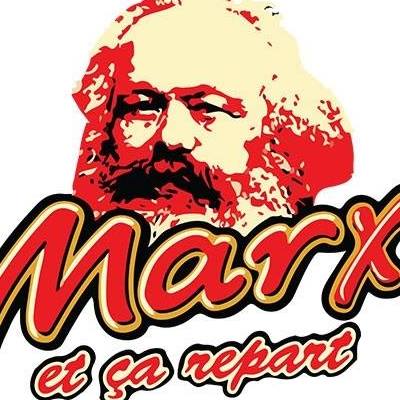« Si Didier Lombard est condamné, personne ne voudra plus diriger une grande entreprise. »
Chiche ?
Vendredi 1er juillet s’est tenue, au Palais de Justice de Paris, la dernière séance du procès en appel de France Télécoms, nous avons entendu les plaidoiries des trois avocats de Didier Lombard, l’ancien PDG de France Télécoms, puis la parole a été donnée pour quelques derniers mots aux deux accusés, Didier Lombard et Louis-Pierre Wenès. Le jugement sera prononcé le 30 septembre prochain.
Quelques notes et impressions totalement subjectives.
Très belle salle d’audience, décorée style Troisième République, hauts plafonds, chaleur étouffante et sièges inconfortables. La matinée commence mal. Plaidoirie de M° Veil un « ténor du barreau ». Une voix bien posée, une élocution lente, coupée de multiples petits temps de suspension. Objectif probable : faire solennel. Résultat, éloquence plus vieillotte que solennelle. Argument central : Didier Lombard n’est coupable de rien, le responsable, le coupable c’est l’actionnaire, c’est l’État. Ou comment disculper d’un coup non seulement son client, mais tous les patrons de toutes les entreprises par actions. Une fois posé ce pivot central, Maitre Veil n’hésite pas à faire quelques détours, il passe par la guerre en Ukraine, Trump, Poutine, l’Europe, Biden. Et même, dans une envolée surréaliste, à comparer Didier Lombard à… Bonaparte franchissant le Pont d’Arcole sous la mitraille. Pour vaincre, il doit passer de l’autre côté du fleuve au péril de sa vie. Didier Lombard, lui, doit franchit la crise du déficit de la Maison France Télécoms sous la mitraille de la critique qui l’assaille de toutes parts au péril de… la vie de ses employés ?
M° Veil se veut plus sobre dans ses conclusions. Relaxe pour Didier Lombard, car, prenez garde, « si Didier Lombard est condamné, personne ne voudra plus diriger une grande entreprise. »
Chiche ?
La deuxième avocate est plus besogneuse. On a bien droit à deux vers de Prévert en guise de mise en bouche, mais Prévert, à côté du Pont d’Arcole… Elle s’attache à démontrer qu’il n’existe pas, dans le dossier de l’accusation, de preuves écrites contre Didier Lombard, donc qu’il ne peut être condamné. Pas de preuves écrites que Didier Lombard ait donné à ses cadres l’ordre de commettre des faits de harcèlement intentionnel contre des individus particuliers sous leurs ordres. Ce que le public, qui connaît un peu la vie des entreprises, admet facilement. Et ce qui n’est pas l’enjeu du procès qui vise justement à sortir de cette définition juridique restrictive du harcèlement moral en entreprise. D’ailleurs, poursuit elle, Monsieur Lombard n’est pas souvent en France, il n’écrit pas souvent, ne sait pas vraiment ce qui se passe dans son entreprise… Elle évite soigneusement les sujets intéressants, comme par exemple le fait que les primes de bon nombre de cadres intermédiaires sont indexées sur le nombre de licenciements qu’ils ont réalisés dans leurs services.
Avec la chaleur, la somnolence gagne l’assemblée et la pause est bien venue.
Après la pause, le troisième avocat de la défense de Didier Lombard s’attaque à ce qui constitue le cœur de ce procès. Il est temps. Une stratégie d’entreprise peut-elle être constitutive de harcèlement moral, comme l’a soutenu l’avocat général dans son réquisitoire, en s’appuyant sur le jugement rendu en 2019 au premier procès France Télécoms qui introduit, d’après lui, une jurisprudence nouvelle sur le harcèlement moral, institutionnel, systémique, et non plus seulement individuel, interpersonnel. L’avocat réfute la notion même, réfute également le fait que le jugement de 2019 constitue une jurisprudence. Et gagner contre Didier Lombard et ses avocats sur ce point constitue bien le cœur de ce procès, parce que cette nouvelle définition, si elle est confortée, ouvre un nouveau terrain d’intervention, de lutte aux syndicats, dans le domaine des conditions de travail et du pouvoir dans l’entreprise, une bouffée d’oxygène dont ils ont bien besoin, ces jours-ci, ils ne sont pas au mieux de leur forme. D’où l’importance de ce procès qu’ils ont su mener de façon exemplaire.
Après une nouvelle demande de relaxe, la parole aux deux accusés. L’un et l’autre vont rappeler à quel point ils sont sensibles aux malheurs des salariés de leur entreprise, sans lésiner sur les moyens. L’un et l’autre, dans deux courtes prises de parole, ont la voix qui se brise, les yeux qui se mouillent lorsqu’ils évoquent les témoignages des victimes qu’ils ont entendus au cours des deux procès. Attitudes que, pour ma part, je trouve convenues.

Lu dans le journal : 1, 2, 3 agressions racistes…
Lu dans le journal : 1, 2, 3 agressions racistes…
Pour glaner quelques informations sur l’assassin des Kurdes de la rue d’Enghien du 23 décembre dernier, j’achète ce matin le Parisien (28 décembre), je lis l’article que le journal consacre à sa famille. Puis je feuillète le journal. Quelques pages plus loin, un autre article : « Le chauffard de Montpellier a été interpellé », sous-titre : Il est soupçonné d’avoir écrasé un adolescent le soir du math France Maroc. Je continue à feuilleter. Dans les pages parisiennes : « Une adolescente de 13 ans se fait tirer dessus par un voisin sexagénaire ». Un meurtre et une agression racistes qui ne disent pas leur nom. Dans le cas du sexagénaire qui a blessé la jeune fille d’origine maghrébine, la mère l’a entendu dire aux policiers qui venaient l’arrêter : « Ce qui s’est passé il y a deux jours (le massacre des Kurdes) m’a donné de la force. » A ce stade, le mobile raciste n’a pas été retenu par la justice.
Le « chauffard », pour sa part, semble avoir pris peur en voyant tous ces Arabes qui défilaient dans la rue, et bloquaient sa voiture. L’un d’eux s’est emparé du drapeau français de la voiture. Pris de panique, le chauffeur a brusquement démarré, écrasé un jeune homme d’origine maghrébine de 14 ans, et pris la fuite en Espagne. La police est parvenue à l’arrêter à son retour en France. Il est actuellement accusé de violence volontaire avec arme (la voiture) ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Toujours aucune référence à un crime raciste par la justice.
Quant à l’assassin des Kurdes de la rue d’Enghien qui hurle sa haine des étrangers avec tant de force qu’on ne parvient pas à le faire taire, on sait maintenant qu’il y a un an, il a attaqué un camp de migrants au sabre, en hurlant : « A mort les immigrés », en blessant plusieurs d’entre eux avant d’être arrêté par les migrants eux-mêmes. Puis les migrants ont été arrêtés, comme l’agresseur, puis déférés devant un juge pour « violences en bande organisée ». L’agresseur, accusé de « violence avec arme », et pas de tentative d’homicide à caractère raciste, s’en est tiré avec un an de prison préventive. Relâché le mois dernier, douze jours après il faisait un massacre rue d’Enghien.
Un journal, trois agressions racistes graves, quatre morts, quatre blessés (au moins) contre des étrangers, des immigrés, des « qui n’ont pas une tête de Norvégien » (dixit un syndicaliste policier à la télé). Et une ligne directrice claire : police, justice, gomment, effacent, nient autant qu’il est possible le caractère raciste des agressions. C’est ce qu’on appelle un racisme systémique. Sur fond d’un bon vieux racisme populaire, revigoré par les discours de Zemmour, des militants RN, ou par les projets gouvernementaux concernant l’immigration. Les paroles haineuses entrainent les actes criminels. La vague raciste n’est pas à nos portes, elle est dans la maison.